George Orwell, Le Quai de Wigan, Climats, 2022 (réed.)
« Le bain du matin sépare les classes plus sûrement que la naissance, la fortune ou l’instruction ». Georges Orwell.
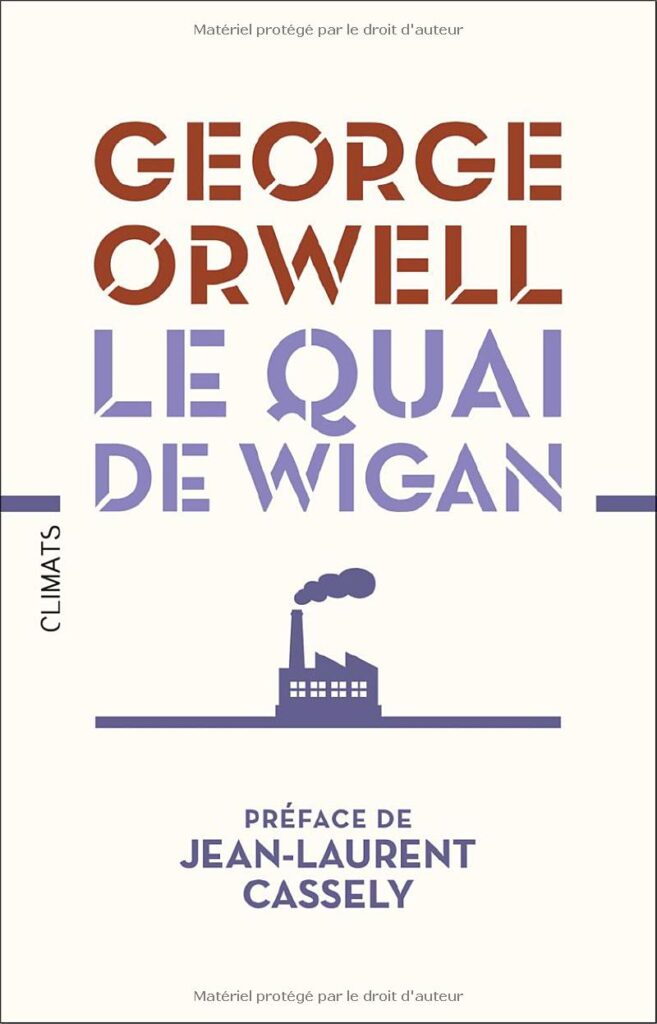
Si vous allez à Wigan, dans le nord industriel de l’Angleterre, n’y cherchez pas son célèbre quai. Celui-ci a disparu, bien avant que l’écrivain George Orwell ne se rende sur place en 1936. Avec « Le quai de Wigan », l’auteur de « 1984 » et de « La Ferme des animaux » nous offre à la fois un témoignage sur les conditions de vie des ouvriers, notamment mineurs, et ses réflexions politiques sur le socialisme.
L’ouvrage, paru en 1937 et qui nous est proposé par les éditions Climats dans une nouvelle traduction, n’a en rien perdu de son intérêt. Il est, selon le préfacier Jean-Laurent Cassely, une « prouesse journalistique, intellectuelle et éditoriale ». Car Orwell ne décrit pas la vie ouvrière. Il a décidé d’en partager, ne serait-ce qu’un temps, le quotidien, les logements crasseux comme le front de taille où à coups de pioche, dans une chaleur étouffante et des conditions éprouvantes, on abat le charbon des heures durant.
« Il faut avoir vu les mineurs au fond et nus pour se rendre compte combien ces hommes sont beaux » écrit-il, la crasse maculant leurs visages leur donnant un « air farouche et sauvage ». Sans eux, pas de développement économique possible ! Et pourtant, on les laisse crever dans la misère quand la maladie s’empare de leur corps et on les laisse vivre dans des logements indignes ou on les exile dans des logements sociaux où leur identité de classe se dilue. Les chômeurs ne sont pas mieux lotis. Ils survivent grâce aux aides publiques car « il n’y a pas de travail, tout le monde le sait », nous dit Orwell pour qui, l’« extrême et inexorable oisiveté » serait un piège pour ces hommes s’ils n’avaient appris à « vivre en éternels assistés (…) sans pour autant s’effondrer moralement ».

Les prolétaires font peur et, nous dit Orwell, les Anglais des classes moyennes et supérieures éprouvent une « répulsion physique » à leur contact. Les sans-dents sentent mauvais : « Le bain du matin sépare les classes plus sûrement que la naissance, la fortune ou l’instruction ». Et Orwell de moquer les bourgeois et intellectuels progressistes qui vénèrent la classe ouvrière mais se gardent bien d’en partager la culture. Orwell sait de quoi il parle, car il fut, dit-il, à la fois snob et révolutionnaire. C’est en s’immergeant dans le quotidien d’un ouvrier ou d’un vagabond, qu’il est parvenu à vaincre le racisme de classe qu’il portait en lui. Il en est persuadé : le socialisme aurait davantage d’adeptes outre-Manche s’il n’était pas « desservi en premier lieu par ses propres partisans », s’il n’attirait pas à lui les « excentriques », nudistes, végétariens, féministes, quakers et autres dissidents de l’église anglicane, parlant un langage ésotérique, étranger au peuple pour qui le socialisme « implique justice et dignité » plus que révolution culturelle, machinisme et planification.

Orwell ne veut pas d’un « monde ordonné, un monde efficace ». Il a le sentiment que les machines ne libèrent pas l’homme mais qu’elles l’affaiblissent : « Se rallier à l’idéal d’efficacité mécanique, c’est en réalité se rallier à l’idéal d’indolence » alors que « l’expérience de la vie se mesure largement en termes d’efforts ». Il ne veut pas d’un progrès qui transforme le monde en un « havre douillet pour petits bonshommes grassouillets ». Orwell l’inclassable défendait un socialisme éthique dont le « véritable objectif n’[était] pas le bonheur mais la fraternité humaine ».
Patsy


