Une boîte à outils confuse à s’approprier
« J'invite le lecteur, archéologue ou non, à s'interroger sur les interdits imaginaires qui bloquent son épanouissement ».
Voici la synthèse des impressions et des remarques d’une partie de la rédaction à propos de Préhistoire du futur. Archéologies intempestives du territoire ou connaître les pays est un repos (1979), dans sa réédition de 2022. Nous avons tenté de restituer collectivement ce qui nous apparaissait (malgré nos limites) comme les mouvements les plus éclairants de l’essai dans l’optique de répondre aux tâches transformatrices d’aujourd’hui. Déjà, nous l’annonçons, cet ouvrage aura inspiré nos réflexions sur les moyens d’émanciper notre discipline et de repenser le rôle social d’un archéologue.
Un geste de piraterie
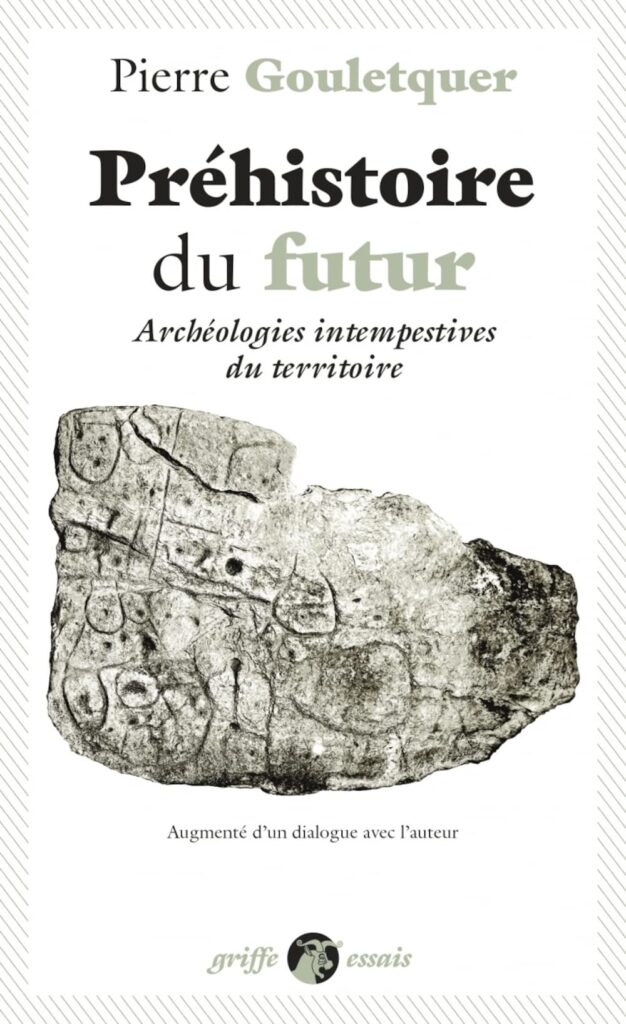
Nous avons découvert les éditions Anarcharsis grâce au mail nous proposant d’examiner la réédition de l’essai, augmenté d’une efficace préface (par Sébastien Plutniak) et d’un précieux dialogue d’une soixantaine de pages entre l’auteur, Sébastien Plutniak et Gwenole Kerdivel, tout deux préhistoriens (le premier d’origine polonaise, le second d’origine bretonne). Un avis « même négatif » en échange d’un volume. Ça nous a paru honnête.
De la même manière, l’auteur était inconnu au bataillon de nos références : Pierre Gouletquer. Présenté comme cet « archéologue paisiblement décalé », conteur, « préhistorien mal venu » spécialiste des industries du sel en Armorique ayant arpenté les rives du Niger dans les années 1970 auprès d’ethnologues, mais qui commença géologue (il rentre au CNRS en 1964 à ce titre) pour mieux dériver vers l’histoire des techniques, des échanges et de la division du travail humain. Sorte d’artiste autodidacte d’à peu près tout (géographie, biologie, journalisme, etc.), proche du cinéaste (et en premier lieu ethnologue) Jean Rouch, il est loin d’être cet humain hors-sol qu’il décrit comme une catastrophe anthropologique. Contrairement aux « handicapés de l’espace » que nous sommes tous, béquilles technologiques imposées dans nos existences oblige (et objets ludiques comme formes détournées de l’exploitation du capitalisme monopoliste d’État), il ne cesse de demander son chemin ici et là de crainte de se perdre, et de nous perdre.
C’est en feuilletant l’ouvrage que nous nous sommes rendu compte du curieux objet que la réputation de notre revue nous avait mis entre les mains. Il était dès lors évident qu’il fallait mener une exploration groupée en milieu inconnu, et possiblement hostile, pour nous offrir le luxe d’un certain recul sur la chose par nos avis croisés. Ou comment installer nos campements en différents points de ce territoire pour mieux l’appréhender : examiner les continuités et discontinuités, les curiosités et les trouvailles d’un environnement dense à débroussailler. Nous voulions capter cette « réalité complexe qu’il faut débusquer » pour livrer les grands traits de l’ouvrage.
Ce que l’outil géographique met en valeur entre les mains de l’auteur, c’est que les phénomènes de l’espace et du temps auxquels nous sommes confrontés sur le terrain ont un rapport à la mémoire. D’abord à la mémoire subjective, individuelle, celle qui fige, ossifie, et qui ne permet pas de reconstituer la complexité de ce que nous recherchons généralement dans l’observation d’une occupation du territoire (la sienne ou d’autres). Pour rompre l’inertie, il y a la mémoire collective qui, par cumul et comparaisons d’analyses empiriques, nous projette hors de nos limites. Si nous partageons, nous nous rendons vite compte qu’individuellement nous enregistrons des éléments selon nos préoccupations particulières ; que, seules, nos connaissances ne peuvent être que partielles. C’est le cadre collectif qui permet de totaliser les connaissances partielles pour en faire des éléments d’interprétation solides.
Quelle est la valeur d’usage de cet essai ?
« Préhistoire du futur peut être considéré comme l'exploration de mon niveau de compétence ».
Rappelons que cet essai n’a pas pour prétention d’imposer des postulats scientifiques rigides, il est destiné au plus grand nombre dans un souci d’éveiller les consciences et d’aiguiser la curiosité sur la notion de territoire. Cette réflexion menée de manière humble et teintée d’humour, est animée d’une volonté, qui se ressent tout au long de cet essai, de s’affranchir des carcans académiques pour s’ancrer dans le réel d’une passion largement partagée dans la population : l’étude de la fréquentation d’un territoire par une succession de générations laissant leur empreinte plus ou moins durable. L’idée « était de prolonger une archéologie de curiosité indépendante des circonstances historiques d’organisation des territoires ».

L’auteur anime sa pensée par la critique ; il avance et rythme son propos par le mouvement critique qui vient déposer des strates de principes à trier et à faire raisonner avec l’actualité. C’est d’abord une critique de la rigidité des méthodes de recherche et de l’individualisme des chercheurs.ses se croyant au-dessus des groupes sociaux, chevaliers solitaires. Or, « c’est un leurre que de vouloir faire croire que la recherche, qu’elle soit archéologique ou autre puisse être individuelle. Le chercheur isolé n’existe pas ». Et pour cause, il dépend des conditions de faisabilité de sa discipline (infrastructures, financements, politiques publiques, …) et des aspérités socio-historiques du temps long (le développement des forces productives). C’est ensuite une dénonciation de l’arrogance presque coloniale des institutions aux représentants parachutés et de certains grands.des chercheurs.ses dédaigneux.euses envers les « passionnés locaux », « les archéologues amateurs » et autres « érudits locaux ». Tous ces laissé.e.s sur le banc de touche, parfois sur celui des accusé.e.s, ou simplement employés comme main-d’œuvre bon marché. Ils sont pourtant les éléments essentiels à la conservation et à la protection des sites sur le territoire, sinon saccagés par le rythme de l’aménagement ou perdus dans l’oubli configuré des contingences historiques.
Depuis la parution de la première édition de cet essai (1979), la loi relative à l’archéologie préventive est entrée en vigueur (17 janvier 2001). La législation du code du patrimoine (partie législative promulguée en 2004) stipule que toutes les découvertes fortuites doivent être déclarées au Service régional de l’archéologie. Cela à un avantage contre le pillage localisé et la marchandisation débridée du patrimoine, mais le résultat est aussi de déconsidérer, voire de dégoûter, les découvreurs qui ne sont pas forcément au courant des démarches administratives pouvant s’avérer insurmontables rien que pour une prospection. En somme, cet essai rappelle qu’il est nécessaire d’inclure les découvreurs.euses (sous la forme d’un dédommagement ou les intégrer dans le processus de conservation et de recherche), ainsi que les associations locales de recherche qui sont les intermédiaires indispensables entre la population et un État de plus en plus lointain et hostile aux préoccupations populaires.
Cet essai rappelle qu’il est nécessaire d’inclure les découvreurs.euses, ainsi que les associations locales de recherche qui sont les intermédiaires indispensables entre la population et un État de plus en plus lointain et hostile aux préoccupations populaires
On pourrait même dire que l’État tient le rôle du truand. En ce sens, ce qu’il faudrait bâtir c’est sans doute une autonomie des structures du patrimoine. Car, nous y reviendrons, la libéralisation de l’archéologie préventive a montré ses effets néfastes. L’État en a évidemment été l’architecte volontaire en tant que garant des intérêts des monopoles, tandis que son contrôle absolu sur « ce qui précède l’action de l’archéologue » ou sur les publications, lui assure une emprise idéologique certaine. La reproduction d’une « pensée unique » est la tâche de l’armée de ses kapos : des mandarins locaux ou des directeurs d’institutions que nous côtoyons régulièrement, profitant des largesses permises par l’euro-régionalisme de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. Le rêve est pour l’une de dépasser les états-nations, freins à la « libre » concurrence, pour l’autre de constituer une Europe sur des bases linguistiques (pour ne pas dire ethniques).
L’État, lui, par cette politique de différenciation territoriale qui consiste à accorder de façon quasiment discrétionnaire des compétences et statuts ad hoc, répond aux revendications des élites locales par pur opportunisme politique, en fonction de ses intérêts immédiats. Science fondamentale et répression se rejoignent donc en ce nœud de contradictions qui se déplace de l’appareil d’État au secteur privé, jusqu’aux vassaux locaux d’administrations de plus en plus décentralisées. Ce qui est créé, par manque de cohésion et du fait d’objectifs politiques, c’est une césure entre « acteurs légitimes et acteurs illégitimes » dont l’arbitrage est assuré par des «principes d’autorité légale et scientifique ». Le résultat est la standardisation des résultats de la recherche et la rétention des données[1], l’abandon des pratiques participatives (prospections populaires, pratiques d’éducation populaire des associations de terrain, …) ou encore la criminalisation des « amateurs ».

Avenir dystopique ou déjà-là réel ? La dématérialisation forcée subie durant les confinements et les tendances scientistes d’une société désacralisée, parlent d’eux-mêmes. Avec l’évolution des forces productives, ce que prophétise l’auteur c’est que « les archéologues seront recyclés dans la maintenance » d’IA, de robots, de sondes programmées (les drones et scanners sont à la mode) « selon les bonnes questions », des « dogmes séculaires » ou « de nouveaux impératifs idéologiques ». De nos jours, les drones et autres scanners modélisant sont désormais à la mode. Sur le terrain, techniciens de surface et conditionnés par la tendance à « l’accumulation des objets et des données », les archéologues sont déjà amputés des conditions de possibilité du plein développement de leurs potentialités. Leur capacité à problématiser, c’est-à-dire à amener de nouveaux problèmes et paradigmes là où il ne semblait pas pouvoir y en avoir, est mise à mal. Le constat est le suivant : curiosité, recul réflexif, déontologie de l’acte, délibération collective, rien n’est en place.
De la culture populaire à l’éducation populaire : la possibilité d’une réappropriation par le bas
« En s'appuyant sur la culture populaire les scientifiques concernés par cette aventure sont sortis du ghetto savant de l'université ».
Ce que l’on ressent fortement à travers cet essai c’est une tentative : celle de rompre avec l’impuissance d’une science emportée par un développement technique jusqu’à en oublier son rôle social et le progrès humain permettant de poser la question, après le « que puis-je savoir ? » du scientifique, le « que dois-je faire ? » du citoyen. Nous avons à faire à une archéologie dominée par le scientisme ambiant dont la caractéristique est de prétendre pouvoir tout expliquer par la technique, jusqu’aux finalités sociales et politiques. L’auteur entreprend d’articuler et de distinguer en même temps une logique de recherche, par la prise de distance théorique (les modèles des bulles de savon, etc.), et une logique d’exposition claire et accessible, par la démonstration rationnelle de cas particuliers. L’oral et l’écrit se veulent complémentaires, bien que l’objet de cette oralité écrite soit souvent ardu à suivre. On y observe le besoin de créer une action dans le mouvement de recherche, allant de l’auteur vers le lecteur et du lecteur vers l’auteur et l’autre lecteur. Le tout est activé par un réseau de pensée qui tente de s’appuyer sur une rigueur conceptuelle.
Le lecteur doit reconstituer, compléter, décomposer pour comprendre et s’emparer de la démarche, sans quoi la lecture est vaine. Et c’est exactement ce que nous essayons de faire ici : ce texte est le résultat du cadre social de la mémoire que nous avons dû édifier, de crainte d’oublier, de faire les frais d’une amnésie collective. Car ce qui n’a aucun relais de transmission disparaît de la mémoire.
Culture populaire et érosion de l’information
C’est avec la distinction fondamentale entre « culture populaire » et « culture savante » que la notion de transmission prend corps dans l’ouvrage. Il y a en effet une transmission horizontale qui se propage sur le mode de la rumeur faisant « tâche d’huile » sur un territoire, mais également une transmission verticale qui se propage par strates hiérarchiques de territoires imbriqués. Le sujet archéologique défini dans l’essai, soit l’objet d’étude de l’archéologue (aidant à la compréhension d’un passé plus ou moins lointain), « transite par des informateurs », si bien que « le message reçu par un informateur n’est pas le même que celui que reçoit le chercheur, pour la simple raison que ce dernier recherche l’objet, alors que l’informateur reçoit l’information sans la chercher ». Cette différence entre objet recherché et découverte fortuite fonde la distinction entre la curiosité populaire et l’intérêt scientifique. Il y a donc une érosion de l’information du bas vers le haut en ce sens que des filtres sont posés. Il y a l’inévitable jeu de la subjectivité (perception de l’objet liée à ses préoccupations immédiates et à ses capacités du moment) qui se double de la suspicion des laboratoires de recherche à l’égard des informations émises par « les cultivateurs, chasseurs ou promeneurs qui ont des idées très précises, voire des hypothèses sur l’organisation de l’espace ».

En retour, une autre forme d’érosion apparaît. Du haut vers le bas cette fois, c’est-à-dire « des hautes sphères de la recherche vers le niveau “informateur”, la donnée ainsi que les résultats sont réduits à des images présentables et souvent « spéctacularisées », puisque science et culture (l’une alimentant l’autre dans les musées) sont de plus en plus soumises à la loi de la concurrence aux financements : il faut valoriser la vitrine de son institution ou de sa discipline comme on valorise le capital d’une entreprise. Et pour cause, les partenariats public-privé inféodent le public aux logiques lucratives du privé. Pire. Lorsque l’entreprise devient sa propre personne, la course consistant à se placer se fait forcément au détriment des collègues. Le prestige par coup de comm’, belles images, reconstitutions 3D, catalogues d’exposition aux pages glaçurées, reportages Arte au parfum d’aventure oblitérant totalement les conditions de travail, et bientôt expérience métavers de la visite de grands sites en réalité virtuelle, ne sont que l’expression marchande d’un appauvrissement considérable de la connaissance restituée.
Il est évident que ce type d’érosion se fait au détriment des campagnes, ce qui n’est pas anodin dans un contexte de polarisation assis sur la constitution de grandes métropoles siphonnant les territoires. Ce processus de concentration concurrentielle approfondit évidemment l’antagonisme ville/campagne, comme nous l’a prouvé le mouvement des Gilets Jaunes, le vote rural pour l’extrême droite ou la mobilisation historique contre la réforme des retraites de ce début 2023. L’érosion est spatiale et les laboratoires, rattachés à des universités elles-aussi prises dans la grande tendance à la polarisation (regroupements d’universités d’une même région pour augmenter les statistiques positives à offrir aux grands classement d’un marché du savoir), se font les lieux de rétention et de centralisation « d’informations de même nature » en tant que « véritables noeuds d’information (…) qui entretiennent à la fois le mouvement convergent et l’érosion ». Ce qui est décrit au cœur de l’essai, c’est la logique d’infantilisation et d’hégémonie de classe soutenue par deux piliers : l’appareil d’Etat[2] visant à la stabilité de l’ordre établi et le marché lucratif aujourd’hui dominé par les monopoles, le premier soutenant le deuxième.

Dans cet essai, contenu et forme sont indissociables. Le réflexe du vulgarisateur qui vise à simplifier pour rendre vulgaire l’objet de la science et le dépouiller des informations annexes, est refusé. Car la vulgarisation, forme privilégiée des scientifiques tentant de masquer une activité déconnectée de la société, part du principe qu’il faut rendre accessible une connaissance sinon indigeste pour les masses peuplées d’individus se caractérisant par leur inculture. Que cela soit réussi ou non (et nous pouvons considérer que l’ouvrage est une étape pour l’archéologie), l’effort n’est pas ici de populariser la science mais de la rendre populaire. La démarche consiste à la restituer, dans sa complexité et sa rigueur, aux acteurs et à ceux qui accueillent scientifiques et institutions sur leur lieu de vie, pour élever la capacité générale du niveau de compréhension. Dans cette perspective, l’auteur use d’un anticonformisme dont l’ironie tente de solliciter et d’éveiller le sens d’une responsabilité civique. Celle-ci consiste à rendre à chaque individu son rôle social et sa dignité d’expression.
Science et culture sont de plus en plus soumises à la loi de la concurrence aux financements : il faut valoriser la vitrine de son institution ou de sa discipline comme on valorise le capital d’une entreprise
Il y a par là l’espoir d’ouvrir la science à ses différentes potentialités d’expression en dépassant sa dimension académique. Il y a comme un appel qui demande au lecteur le secours de son inépuisable expérience quotidienne pour combler la science de ses besoins et de ses passions. « Préhistoire du futur » peut être perçu comme un levier pouvant nous servir à fonder une pratique scientifique organique et totale, émancipatrice et consciente. C’est-à-dire une pratique mêlant recherche et exposition des résultats, rigueur scientifique et accompagnement des faits par des populations actrices de leur propre mémoire. Et donc de l’histoire en train de se faire.
L’expérience de l’éducation populaire au service de la connaissance
Prenant l’exemple des sciences naturelles à travers le cas de la création, en 1959, de la Société d’étude et de protection de la nature en Bretagne (SEPNB, aujourd’hui Bretagne vivante), l’auteur fait état de la réussite d’une « expérience d’éducation populaire ». Le succès se place tant sur le plan des résultats scientifiques que démocratiques et économiques. Grâce au réseau des observateurs spontanés, les études sur l’évolution du patrimoine naturel ont été largement enrichies, tandis que les actions de protection ont été renforcées. Des conférences, des sorties et des rencontres ont, elles, permis de restituer les connaissances du moment. Enfin, par l’inclusion des « collaborateurs amateurs », le nombre de salariés de l’association et des sites gérés par celle-ci a augmenté. Résultat ? « En s’appuyant sur la culture populaire, les scientifiques concernés par cette aventure sont sortis du ghetto savant de l’université et se sont positionnés au-delà des règlements pour les faire évoluer. Ils ont créé une dynamique propre capable d’influencer le législateur ». Ce qui renvoie aux expériences vivantes des groupes de recherche et d’études des territoires archéologiques (GRETAB, GRABE, etc.), capables de regrouper étudiants, archéologues professionnels, amateurs d’associations pratiquant l’archéologie tout au long de l’année, ou simples curieux.
Il faut veiller car, plus que de simples informateurs ou « découvreurs individuels », nous sommes potentiellement tous les dépositaires historiques des mémoires locales, animés à la fois d’une « curiosité spontanée » (« l’intelligence pour le réel ») et d’un devoir envers le patrimoine collectif (celui du volontaire conscient des enjeux historiques). L’un ne devant pas prendre le pas sur l’autre, le risque se situant aussi bien dans la dispersion des connaissances que dans le désenchantement des différents types d’acteurs.

Ces expériences concrètes que Pierre Gouletquer utilise comme boussoles, nous rappelle que les archéologues n’ont jamais attendu les institutions étatiques pour créer de la donnée. Par conséquent, les structures type « groupe de recherche », ancrées sur un territoire et héritières des sociétés savantes, permettent d’inclure les classes populaires qui, sous les effets conjugués du technocratisme ambiant et de la répression morale et scientifique, ont tendance à tourner le dos à toute approche organisée par une « institution experte ». Ainsi, le tuteur et supérieur hiérarchique de l’auteur, Pierre-Roland Giot, se fait la figure emblématique de cette tendance caractérisée par le conformisme et la fausse tolérance (celle qui exclut toute altérité) au travers de son acharnement contre un petit entrepreneur de travaux publics qui, mal informé par un assureur, utilisa un cairn (un tumulus), monument mégalithique du Néolithique, comme carrière pour empierrer une route. Faute d’un suivi suffisamment démocratique du patrimoine, le petit patron fit les frais d’une punition exemplaire qui le mit sur la paille à la suite d’un procès inégal contre l’Etat. « Giot connaissait (pourtant) l’existence de ces buttes qui lui avaient été signalées (…) et dont il n’avait pas compris la nature ». L’auteur ajoute : « La personnalité très particulière de Giot a joué un rôle important dans cette affaire, et quelqu’un de plus compréhensif aurait peut-être réagi différemment ». S’il y avait eu quelqu’un donc, ou une structure implantée sur le territoire et dont le rôle aurait été de gérer ce genre d’affaires par l’entremise d’individus issus de la région, avec pour objectif d’élever les consciences et non de les braquer.
« Préhistoire du futur » peut être perçu comme un levier pouvant nous servir à fonder une pratique scientifique organique et totale, émancipatrice et consciente.
L’auteur livre ce qui en a résulté : « Avec une telle politique, l’archéologie préhistorique en Bretagne s’est enfermée dans un camp retranché en posture défensive ». Ce cas-là, agrémenté de la folklorisation des campagnes lorsque le même Giot « déclarait (à un colloque de 1982) qu’en Bretagne on ne pouvait pas prospecter sans être accueilli à coups de fusil », traduit bien « la méfiance des pouvoirs vis-à-vis des populations » et la crainte des rencontres pouvant s’avérer fécondes. L’exemple de Noël Vigouroux, cultivateur devenu minéralogiste et informateur actif suite à la « découverte d’un souterrain gaulois dans l’une de ses parcelles », met en lumière la question du temps : « l’intérêt de l’observateur non institutionnalisé est illimité dans le temps », là où « dans notre espace-temps d’archéologues, la publication de la découverte mettait un terme à notre intérêt ».
Il ne faudrait pas oublier que les découvertes scientifiques sont à la fois le fruit du hasard (elles sont involontaires – ici des prospecteurs amateurs par exemple – et d’une volonté consciente, celle du chercheur, qui doit savoir se déplacer en-dehors des données qu’il a connues (comme un certain Pasteur). Plus encore : que beaucoup des grandes découvertes conceptuelles et scientifiques ont été le fait d’individus situés en-dehors du domaine de recherche en question, puisque les acteurs du domaine sont souvent pris dans leurs données, dans leur rythme, dans leur formation intellectuelle ne leur permettant que de s’inscrire dans un prolongement[3].

Dans cet essai, Gouletquer tente d’armer l’archéologie d’une ambition : celle de rejoindre l’Éducation Populaire. Il se déplace en dehors du champ de la mystique de la science impartiale, soi disant détachée des rapports de pouvoir, par des voies inédites qui lui sont propres (nous y reviendrons). Est affirmée la valeur collective du travail de chercheur : « je n’ai jamais travaillé seul » ou « le chercheur isolé n’existe pas ». En effet, « il n’est rien en effet sans l’apport constant des faits élémentaires qui s’organisent en ensembles cohérents, mais il n’est rien non plus s’il ne cherche dans son contact avec les autres des supports à la réflexion la plus créatrice » ; « c’est peut-être pour défendre cet isolement méprisant que certains chercheurs restent si froidement descriptifs, et ne quittent leur réserve bougonne que pour vilipender les foules incultes qui les entourent ».
Entre manifeste et récit mêlé de concepts soutenus par des cas concrets, l’objectif semble être d’en finir avec la figure du sachant actuellement hégémonique et que l’auteur a déjà endossée sur des stages de fouille où il a eu « l’impression de diriger un groupe de “zombies” pour qui la seule préoccupation était de se voir désigner une surface rigoureusement délimitée sur laquelle ils allaient passer un mois ». Dans le cadre d’une décomposition intellectuelle majeur prenant racine dans une logique libérale du progrès technique et des institutions au service du capital, le chercheur est configuré à se faire l’agent et la victime de l’efficacité économique, des critères de sélection visant à la reproduction de classe, du ratio coût/bénéfice au profit des investisseurs du savoir (les fondations privées ou les grands groupes du BTP). Rejoignant Jacques Rancière et son Maître ignorant, il a, du choc de cette expérience de terrain, formuler un constat d’ignorance partagée sur les questions de transmission, d’organisation et d’apprentissage. Il a observé une dynamique d’auto-initiation ou d’« enseignement de type initiatique » permettant l’acquisition par l’expérience et non par la lecture. Cet évènement fut d’ailleurs l’élément déclencheur de sa réflexion sur le territoire.
La définition des termes déterminée par le rapport de force et l’activité humaine
Développant les notions de continuité-discontinuité d’un territoire, l’auteur met en lumière une idée centrale : « cette dualité continuité-discontinuité sous-entend nécessairement des relations de dépendance entre un grand nombre de petits éléments et un ensemble continu qui les contient, c’est-à-dire une relation de pouvoir ». Ainsi en va-t-il encore des villes vis-à-vis des villages ou de l’homme politique breton ne pouvant être « qu’un élément du pouvoir français ». Ce qui lui permet de poser la question motivant le geste de l’archéologue : « quelle relation peut avoir existé entre l’individu enterré tout seul sous un tumulus et ses contemporains ne jouissant pas du même privilège ? ». Si cette question du rapport de force dans la société est le socle de nos interrogations scientifiques, elle doit l’être aussi du point de vue de la structuration de l’archéologie d’aujourd’hui. À l’évidence, « toute l’archéologie actuelle se développe à partir de la notion de patrimoine ». Or sa définition dépend du groupe social au pouvoir.
Nous l’avons vu, la répression d’État fait loi jusqu’à transformer les tenants de la science fondamentale en juges. C’est pourquoi la dissonance entre l’ensemble (le haut lieu de l’institution) et le sous-ensemble (les curieux et les amateurs) se manifeste violemment dans notre discipline. Elle se dresse parfois frontalement contre ceux qui vivent sur place, « au contact de l’objet de l’étude » puisque « ceux-ci ne peuvent intervenir à aucun moment, ni dans la définition de cette étude, ni dans son déroulement, ni dans le rejaillissement de la connaissance acquise ».

Pierre Gouletquer, en considérant « les territoires comme l’action discontinue de l’homme sur une surface continue », nous rappelle que le travail de l’Homme est ce qui modifie en profondeur les sociétés. Ce rapport au temps fait le rapport à l’Histoire de l’humain, avec ses accalmies, ses accélérations, ses catastrophes, ses temps intenses et d’accélération, ses continuités et discontinuités manifestes marquant l’environnement et le monde des idées. Il s’agit de sa capacité à transformer son monde. Il n’y a que notre mémoire qui fige le temps humain. L’archéologie existe justement pour y remédier en essayant « de comprendre de quoi est faite (…) l’action (de l’homme), à travers les marques qu’elle laisse à la surface ». Tout comme l’auteur tente de donner corps aux marques de l’action discontinue de l’Homme, nous essayons par ce texte de donner une cohérence aux éléments discontinus et dispersés de l’essai.

Aux limites d’une archéologie dépourvue de langage propre
« Nous avons dévoré les objets sans en apprécier la valeur ».
Pierre Gouletquer présentant sa carrière comme une œuvre d’art, reflet de sa personnalité et de ses inquiétudes de citoyen, militant, conteur, pédagogue et fils de prolétaire, son ouvrage ne pouvait être une œuvre de recherche pure. En fait, les circonstances immédiates dans lesquelles l’auteur à écrit dominent largement. On pourrait dire que le pari est parfois réussi : un cas concret condense le cadre théorique général qui sert à l’analyse spécifique et celle-ci permet de le mettre à l’épreuve. Ainsi, l’auteur lâche : « je reconnais donc m’être trompé, par exemple lorsque après avoir appliqué des principes simples pour localiser des sites archéologiques, je me suis aperçu que j’utilisais certains éléments de la théorie de la géographie des marchés. Ou encore lorsque j’ai reconnu dans les figures de la géométrie de bulles de savon des éléments essentiels de la gestion des territoires. Mais je ne me suis trompé que momentanément, le temps d’étudier ces principes théoriques et de les confronter avec des réalités concrètes ». Lien dialectique entre formalisation théorique et concrétude pratique, il s’oppose par là au « terrorisme intellectuel » de certains de ses pairs préhistoriens, détenteurs d’une vérité éternelle brandie comme un bâton pour battre le profane.

Il faut l’avouer, l’articulation des modèles empruntés notamment à la géographie pour aborder l’évolution du territoire, les dynamiques de peuplement ou la perpétuation des mémoires, nous ont quelque peu perdu : parcours, limites et frontières, modèles des bulles de savon, distances de respect et pôles concurrents d’attraction déterminant des directions d’exploration sur une surface (le territoire) jamais homogène, etc. Les grandes phases du développement ne nous ont pas toujours paru claires. Il a fallu des discussions et un travail de relecture un tant soit peu rigoureux pour se réapproprier l’armature intellectuelle qui ordonne des éléments en apparence si disparates.
Continuité et discontinuité, la dialectique du moment
Revenons sur les notions cardinales de territoire continu, « constituant un territoire linéaire unique » en un seul réseau, et territoire discontinu, aux ruptures multiples ». Ces territoires émettent en effet de l’information que nous pouvons recueillir et interpréter » nous dit l’auteur. Il est possible d’opérer un rapprochement de la dialectique du moment territorial avec la dialectique du moment historique du philosophe allemand Friedrich Hegel, celle-ci mettant au cœur du changement et du progrès la volonté humaine.
Dans cet essai, Gouletquer tente d’armer l’archéologie d’une ambition : celle de rejoindre l’Éducation Populaire. Il se déplace en dehors du champ de la mystique de la science impartiale, soi disant détachée des rapports de pouvoir, par des voies inédites qui lui sont propres
« Le territoire fauché et sa limite impliquent une notion de travail, et par conséquent de fatigue ». Prenant l’exemple du faucheur avançant dans l’herbe grâce à sa force de travail qui n’est pas infinie et qu’il doit reproduire avant de continuer : « la progression de son territoire dépendait du rapport entre sa puissance de travail et la résistance de la surface elle-même ». Ce qui nous rappelle que l’histoire est encore une fois dialectique (contradictoire), circulaire, en devenir constant, et que ce devenir ne se définit qu’au travers des actions des hommes contraints par certaines formes sociales et par l’état des forces productives (savoirs techniques et scientifiques, machines, systèmes, outils, ensemble des individus, …). C’est-à-dire qu’il y a une faisabilité des potentialités historiques : le sens pris par l’histoire dépend de l’impulsion donnée par le sujet social dans un certain type de rapports sociaux. Ce dernier façonnant le territoire par son activité, son progrès implique l’impossibilité d’un quelconque retour en arrière : « l’herbe ne repoussera pas de la même manière là ou elle a déjà été fauchée. Mais elle repoussera quand même ». Aussi, deux forces opposées d’égale intensité mais en direction inverse, engendrent un mouvement qui se fait moment : « Il se trouve toujours un moment où l’un des faucheurs décrète qu’il n’y a plus de Pyrénées (la limite), pour déborder chez son voisin ». Dès que l’on a une approche dialectique, et non pas inerte et figée des choses, que l’on prend le réel à bras le corps, on se rend compte qu’une période historique repose sur un conflit plus ou moins manifeste.

Il est donc possible d’appréhender ces notions de continuité et de discontinuité comme le reflet, sur le territoire, des successions de processus faisant le développement historique et que le matérialisme dialectique met en lumière ; ce guide pour l’action, solidaire d’une compréhension du monde social qui insiste justement sur sa continuité et sa discontinuité pour ordonner les moyens de le transformer. Le processus est tout ce qui est engagé dans un mouvement, un changement constant, avec ses continuités et discontinuités, phases de concentration lentes et irruptions violentes. Lorsqu’on appréhende une réalité comme un processus, on pense le lien entre le présent et le futur : on modifie la réalité présente en l’inscrivant dans les modalités à venir. Le présent devient transition et le futur ensemble de significations pour le présent (le futur comme source du présent change la signification du présent). Car les changements d’un territoire sont réels et fondamentaux, régis qu’ils sont par certaines lois que l’auteur tente d’ailleurs de capter tout au long de l’essai. On peut dire que chaque réalité repose sur des modalités passées et présentes, tandis que le présent est le début d’un nouveau processus. Les changements s’opèrent donc sur le temps long et mettent en jeu beaucoup d’individus appartenant à des générations différentes, dans un processus continu dont il faut regrouper toutes les traces pour pouvoir le saisir dans son épaisseur.
Contaminée par la logique accumulatrice de notre mode de production, notre discipline s’abime dans l’extractivisme et le refus du récit totalisant aidant à cerner la diversité des particularités concrètes. L’archéologie est figée, rendue inerte par un fixisme intellectuel l’empêchant de penser ses propres contradictions.
C’est de la praxis dont il est en fait question ici, à savoir l’action pratique de l’Homme produisant le monde social. Dans un autre sens, le monde social est à prendre comme résultat de l’industrie et de la société, et en cela pur produit historique. Ainsi, le réel est une construction s’identifiant à une « durée qui naît du travail et d’une chronologie qui n’est autre que la mise en forme de la production » (Michel Clouscard, Les chemins de la Praxis, (réed.) 2015). Ce qui permet le changement d’un état à un autre, c’est donc qu’un processus historique passé est le point de départ d’un nouveau. Il n’y a en ce sens jamais d’origine mais simplement un long processus socio-historique (le temps humain est autre que celui de la nature) dont les caractéristiques s’expliquent par des mouvements cycliques. En apparence multiples, ils sont pris dans un processus global et cohérent qu’il s’agit de saisir par l’analyse et la synthèse.
Une discipline figée
Nous retenons ce geste dialectique du mouvement car il pointe du doigt le stigmate : l’archéologie est malade. Contaminée par la logique accumulatrice de notre mode de production, notre discipline s’abime dans l’extractivisme et le refus du récit totalisant aidant à cerner la diversité des particularités concrètes. L’archéologie est figée, rendue inerte par un fixisme intellectuel l’empêchant de penser ses propres contradictions.
Et pour cause, l’archéologue a ses hochets. La discipline n’a effectivement pas su fondamentalement se renouveler, « ni dans ses techniques (creuser pour trouver), ni dans ses méthodes (détruire pour comprendre), ni dans l’utilisation de ses résultats ». Des innovations existent certes à la marge (pour l’élite des reportages), mais la volonté de les systématiser et le manque de moyens en font des symboles. L’archéologie, pour se faire une place au soleil terne des sciences humaines et sociales, a préféré les quitter ou les trahir. Elle « s’est modernisée en faisant appel aux autres sciences, et parfois à ce que celles-ci ont de plus sophistiqué (datation radiocarbone, informatique, géophysique, etc.), mais elle n’a rien créé de nouveau, et n’a dégagé aucun principe fondamental qui soit utilisable par une autre science ». De fait, le chercheur archéologue devient l’expert du consensus, indolent et peu enclin à questionner au-delà des paysages configurés de ses pairs. Aussi, pour l’auteur comme pour nous, « il est symptomatique (…) que les progrès de l’archéologie soient souvent dus à des amateurs qui, toujours sur la brèche, détectent les découvertes fortuites (…) ».

Bien qu’il est essentiel, pour renouer avec la volonté de reconstituer les rapports sociaux d’alors, de se doter d’outils conceptuels faisant le pont entre étude des traces matérielles des populations passées et analyse des continuités historiques, il nous a semblé que l’essai manquait de structure. Celle qui permet sa reprise en main à l’heure où nous recherchons plus que jamais de la clarté dans la confusion : de l’analyse pour agir, un système comme boussole pour l’action. Ce que l’auteur récuse d’ailleurs formellement par son rapprochement poussif de la discipline avec l’art : « je peux aujourd’hui affirmer que l’archéologie sert à faire rêver ». Ou encore : « c’est un art du récit, et nous pouvons libérer celui-ci et faire en sorte qu’il ne se dessèche pas en un ensemble d’images toutes faites et de dogmes stériles ». Seulement, c’est en liant les facteurs subjectifs (les consciences et les représentations) et objectifs (les conditions d’une situation donnée) qu’une science peut répondre à l’ambition qu’elle se fixe : ici, comprendre le fonctionnement d’un société située dans le temps à travers ses particularités matérielles qu’il s’agit de faire parler. Le récit, s’il est nécessaire pour ne pas tomber dans les travers de la recherche aride, doit être raisonné. Nous ajoutons un deuxième moment, souvent oublié, et qui fixe pourtant le sens de la recherche : déceler dans l’ancien les sentiers de l’horizon d’avenir.
« Depuis deux siècles, l’archéologie a suivi une route étroitement déterminée par les progrès des techniques d’aménagement des territoires, orientée par la tendance générale à l’accumulation d’objets et de données que l’on peut en tirer »
L’observation de Pierre Gouletquer parle ici d’elle-même : « Depuis deux siècles, l’archéologie a suivi une route étroitement déterminée par les progrès des techniques d’aménagement des territoires, orientée par la tendance générale à l’accumulation d’objets et de données que l’on peut en tirer ». Le rapport aux forces productives et à ce qu’on en fait détermine en effet le sens du progrès humain.
Des pistes qui rencontrent les impératifs de l’époque
« L'archéologie d'aujourd'hui est efficace par rapport à celle de notre artisanat du XXe s, tout comme l'est la grande distribution par rapport à l'infinité des petits commerces qu'elle a écrasés ».
Pour introduire le dialogue, Pierre Gouletquer termine par ces mots : « bien qu’il soit lesté de quelques dizaines d’années d’expérience et de réflexion, il est douteux que cet ultime essai parvienne à (égratigner la couche de glace sur lequel il a ricoché) ». Cette épaisseur givrée nous ne la connaissons que trop bien : nous peinons aussi à l’entamer. Mais à force de patience et en guettant le moment opportun par l’analyse concrète des situations concrètes, nos efforts paieront.
L’auteur semble déployer les bases d’une dialectique imparfaite allant de la méthodologie au politique. Par là, il évite de tisser des vérités toutes faites et éternelles. Il donne, surtout dans le dialogue, un élan pour régler les modalités d’action au regard de l’époque. À en juger par les séminaires et tables rondes policées (ne jamais déborder, flairer le moment de la flatterie ou du coup bas, …), l’archéologie préfère aujourd’hui le consensus mou et scientiste, au débat rationnel et transparent, ainsi qu’à la controverse salvatrice permettant de faire bouger les lignes. Il faut donc batailler, créer des collectifs de lutte immédiate (les Groupes Archéo en Lutte), des associations d’étude et de recherche territoriale (GRABE : Groupe de Recherches Archéologiques de la Bruche et Environs) et des revues critiques tournées vers la transformation sociale (Notre Condition), pour bousculer un monde déjà mourant, renouer avec le travail collectif et faire oeuvre commune. Car la santé d’une vie démocratique (nous entendons par là le processus de délibération engageant tous les acteurs d’une entité) se mesure à la possibilité d’une réflexivité collective ordonnée selon le principe de vérité et refusant l’opportunisme.
La vitalité de la discipline dépend autant du contenu réel que du processus d’interaction, c’est-à-dire des modalités d’organisation de la science : qui décide des fins et des moyens du métier ? Comment élire sa hiérarchie ? Comment mailler le territoire efficacement ? Comment fouiller, à quelles échelles, en combien de temps et pourquoi ? Comment rémunérer les archéologues ?

Certaines des questions posées dans l’essai touchent en effet au cœur des impensés de notre discipline, par crainte de tout remettre en cause, par habitude de ne pas penser : « que cherche t-on exactement lorsque l’on fait une fouille ? Si c’est ce que l’on retire comme enseignement au début de celle-ci, nul n’est besoin d’améliorer la technique. Si c’est ce que l’on cherche en fin de fouille, la perte d’information du début peut être considérée comme importante et on pourrait y remédier par une réflexion sur la fouille avant de l’entreprendre ». C’est la question des techniques et de la formation qui est en jeu ici. Car la recherche archéologique de terrain (et le message qu’elle engendre) ne connaît pas la répétition : « pour comprendre son client, le psychologue l’écoute parler. Pour comprendre le sien, l’archéologue lui enlève des morceaux ».
On peut dire que les progrès extractivistes de l’archéologie sont l’exagération de l’idéologie du collectionneur mondain/notable des premiers temps, happée et remployée par la logique accumulatrice moderne. L’extraction des données en archéologie se fait le reflet de l’accumulation des capitaux.
La question de départ est : à qui doit servir l’archéologue et quelles sont les raisons de sa discipline ? Objectivement, l’archéologue professionnel, même avec les meilleures intentions du monde, est un récolteur terroriste, intégré qu’il est à des structures prédatrices. Il faut donc partir du constat que « l’accumulation d’objets ne conduit pas forcément à l’enrichissement des connaissances ». Sans finalité fixée collectivement par la profession intégrant la société (communes, riverains, travailleurs des anciennes usines, etc.), notre discipline n’a pas de sens, ou un sens limité par le principe accumulateur. On peut dire que les progrès extractivistes de l’archéologie sont l’exagération de l’idéologie du collectionneur mondain/notable des premiers temps, happée et remployée par la logique accumulatrice moderne. L’extraction des données en archéologie se fait le reflet de l’accumulation des capitaux. On comprend donc que l’institutionnalisation (INRAP en 2001) puis l’ouverture au marché (2003) entraînant l’ubérisation de la profession, n’ont pas favorisé une démocratisation mais une privatisation de la production des savoirs.
L’origine familiale (fils d’ouvrier) et le parcours professionnel de Pierre Gouletquer nous rappellent bien que l’archéologie institutionnelle a en fait démocratisé deux choses : d’une part le cloisonnement disciplinaire (on doit rester spécialiste de la spécialité correspondant à son dernier diplôme), empêchant la curiosité du chercheur de se déployer. En effet, « l’immense majorité s’amputent délibérément de leurs autres talents pour se faire reconnaître comme scientifiques, pour assurer une carrière (…), pour gagner une médaille ». On se souviendra de la médaille honorifique de l’INRAP attribuée aux anciens travailleurs à l’occasion des vingt ans de l’institution, à défaut d’augmentation des salaires. D’autre part, la reproduction sociale selon des procédés de recrutement et d’autorisation de fouille par cooptation et allégeances. Recruté en 1963 au CNRS par Giot, l’auteur observe qu’il a sans doute été le seul préhistorien d’extraction populaire[4] à entrer dans cette institution et qu’aucun de ses collègues ne pouvait se douter de « l’ampleur du gouffre d’inculture qui nous distinguait » (parlant d’un de ses collègues, fils d’instituteur).

« L’ascenseur social » n’est en fait que le résultat de la stratification en classes poreuses de notre formation sociale ayant remplacé l’imperméabilité des ordres de l’Ancien Régime. Cette « liberté de passage » a permis de justifier le pouvoir de la bourgeoisie par le travail accumulé contre les privilèges du sang, avec pour résultat la constitution de grandes dynasties en concurrence les unes avec les autres et se jugeant paradoxalement selon les critères du faste aristocratique. La porosité garantit également une grande capacité de résilience du point de vue social, économique ou idéologique : lorsqu’une crise survient (c’est-à-dire une transition) ou qu’un besoin en nouveaux cadres de la production se fait sentir du fait de transformations dans le mode de production, le système de classe, souple, assure le transfert. Il n’empêche que les classes restent homogènes et que les éléments transfuges, comme Pierre Gouletquer, sont sommés d’éviter « le misérabilisme … ». C’est-à-dire d’oublier leur ancienne socialisation (dite primaire) pour s’intégrer à un style de vie, un mode de conduite, une gestuelle, une culture supérieure masquant le réel.
Aujourd’hui, cet héritage dominateur et oligarchique se traduit dans la tendance lourde à la bureaucratisation et à la gestion technocratique d’un métier de plus en plus stratifié, où la collusion avec les hiérarchies privées est évidente, y compris à l’INRAP
À ce titre, ce passage est évocateur : « au lieu de faire valoir ce que pouvait apporter un géologue à son équipe et de vanter les qualités réelles s’il en est, (Pierre-Roland) Giot (son mentor donc) m’avait fait passer pour ce que je n’étais pas. En clair, il m’avait adopté, effaçant ma famille et tout ce qui l’entourait, un peu comme on adopterait un enfant en escamotant toute trace de son origine ». L’archéologue a beau se présenter comme progressiste ou de «gauche«[5] , sa fonction est aussi le produit d’un héritage colonialiste et impérialiste incarnée par les notables et les grands bourgeois d’alors. Aujourd’hui, cet héritage dominateur et oligarchique se traduit dans la tendance lourde à la bureaucratisation et à la gestion technocratique d’un métier de plus en plus stratifié, où la collusion avec les hiérarchies privées est évidente, y compris à l’INRAP[6]. Le pouvoir de ces institutions se maintient de façon nette par l’imposition de normes (juridiques, managériales, de formation, …) évoluant au gré des besoins du marché.
Mais dans toute situation s’entrecroisent les éléments appartenant au passé et à l’avenir : les deux se confondent et des contradictions produites adviennent les possibles. Toute construction d’un nouveau monde prend racine au cœur des contradictions de la structure sociale présente.
Changer la représentation que l’on se fait de notre métier pour le transformer concrètement
Si l’universel est une totalité qui synthétise tous les fragments des particularités humaines, l’archéologie n’en est pas loin. Du moins elle porte en elle les germes du dépassement de l’ultra spécialisation de la division du travail capitaliste qui nous éloigne de la maîtrise de la chaîne opératoire. Un archéologue total est possible, capable d’action pratique et de pensée théorique, ayant dépassé les activités mutilées, incomplètes. Ce qui implique de rompre avec la mise en concurrence des chercheurs animés par le « moi plutôt qu’un autre » et débouchant sur l’entrechoquement des acteurs pour les sites les plus prestigieux ou l’accumulation forcenée des données comme des publications. La multiplication des monographies qui ne construisent rien d’opérant, aucun modèle viable pour la société puisqu’elles sont détachées de toute ambition anthropologique, sont les symptômes du règne de la science comptable. L’auteur le pointe : la discipline est soumise au syndrôme de Diogène qui consiste à collecter plus que de raison, soit en dehors du « ça peut servir ». « Le moi plutôt qu’un autre » s’adosse au « c’est chez moi » du scientifique parachuté sur un territoire comme un politicien en campagne. Et le chez soi du scientifique est constitué des dépôts, des musées, des laboratoires, … La tour d’ivoire des experts.
Au lieu de se comporter mimétiquement comme nos maîtres, c’est-à-dire en s’arrachant des parts d’un gâteau avarié et en menant une lutte des places, rejoindre une philosophie de l’Histoire prenant en compte la centralité des rapports sociaux, de production et de consommation, permettrait de sortir de cette conception limitée du patrimoine : le patrimoine accumulateur de monuments et d’objets, les uns servant de vitrine de prestige aux entreprises ou aux communes (transformées en startup), les autres issus d’une logique prédatrice imposée aux populations dans le sillage de monopoles de l’aménagement. Jusqu’à présent, les archéologues professionnels se font objectivement les collaborateurs des intérêts privés.

Il faut donc reconsidérer la spécificité de l’utilité sociale de notre métier en partant de ce qu’il produit concrètement et d’où : de la donnée, des études, de la sauvegarde du patrimoine et de la transmission, dépendant et prenant racine dans les temps courts de variation des structures humaines et des événements historiques que l’aménagement du territoire reflète. Loin du temps infiniment long des cycles naturels, nous sommes au carrefour d’une réalité sociale immédiate, en train de se déplacer sous nos yeux, et du monde social sédimenté, reprenant vie au contact des aspirations humaines une fois déterré.
Il faut maintenant partir du problème à la fois démocratique et anthropologie qui nous force à choisir entre deux visions :
- Soit on considère que l’activité de l’archéologue est totalement consciente d’elle-même et qu’elle est complétée par l’acte du public qui doit comprendre et auquel il faut expliquer. On se place alors du côté de la subordination du public par le sachant, l’appareil d’État et les structures privées.
- Soit on part du principe que l’acte de découverte, d’étude, de sauvegarde du patrimoine et de cheminement des connaissance, se fait avec et grâce au public, cet observateur souverain. Que ce dernier peut aussi découvrir, créer des problématiques, développer des interprétations ou des idées, et de fait devenir décisionnaire. On se place alors du côté de la responsabilité individuelle et de la cogestion de la mémoire matérielle et immatérielle. L’expérience de la discipline en serait totalement transformée, la définition du collectif de travail élargi à des types de participants jusque-là déconsidérés. Tout bonnement, le public disparaîtrait puisqu’il deviendrait acteur.
Si on opte pour la deuxième solution – la transformatrice – il faut sortir le patrimoine (et la culture) de la logique de la production de marchandises (l’actuelle valorisation des territoires, qui est en fait celle du capital des grands groupes) et le public de son rôle de consommateur. Ce qui implique de mettre concrètement la pratique scientifique en sécurité sociale, à savoir sous contrôle des intéressés (travailleurs du patrimoine et public amateur), en leur garantissant une vie matérielle et une autonomie ancré dans des lieux de coordination et de décision[7]. Le tout dépendrait de critères de conventionnement à établir par les concernés[8]. C’est au demeurant une perspective largement valable pour les autres disciplines et déclinable à d’autres secteurs (sécurité sociale de l’alimentation, des transports, de l’énergie, etc.) et largement réalisable pour notre profession qui doit prendre conscience de sa capacité de nuisance : son pouvoir bloquant.
Marcel Duchamp nous met sur la voie d’un processus observable dans d’autres domaines que l’art, et notamment dans la recherche scientifique :
« L'artiste n'est pas seul à accomplir l'acte de création car le spectateur établit le contact de l'œuvre avec le monde extérieur en déchiffrant et en interprétant ses qualifications profondes et par là ajoute sa propre contribution au processus créatif. »

Par là, nous pouvons revenir sur la réticence formulée à l’encontre de l’idée que l’archéologie serait, de l’avis de l’auteur du dialogue, plus un art qu’une science : un art du récit servant à faire rêver. L’idée, polémique dans la forme, recèle une vérité insoupçonnée et il n’est effectivement pas anodin que nous figurions parmi les nombreux secteurs de la Culture. Car si l’artiste s’épanouit sur le terrain de la passion humaine (l’amour, l’étrange, la haine, l’inconnu, etc.) avec pour rôle de faire sentir la force de cette expérience grandiose, nous pourrions en dire tout autant de l’archéologue. N’est-il pas celui qui reconstitue les rapports sociaux, soit les modes d’agencement qui déterminent ces passions ? Pour les rendre préhensibles et les livrer dans toute leur complexité, ne doit-il pas les exprimer de la manière la plus intelligible et sensible possible ? L’archéologue serait l’artiste de l’Histoire matérielle des Hommes, obligé de s’intéresser à tout pour devenir spécialiste de son domaine. Obligé d’explorer ses limites pour ne plus être assujetti au contenu préalable (d’une étude par exemple) et faire grandir son art.
Il faut sortir le patrimoine (et la culture) de la logique de la production de marchandises et le public de son rôle de consommateur. Ce qui implique de mettre concrètement la pratique scientifique en sécurité sociale
La revendication d’une intermittence des travailleurs du patrimoine (définis selon les termes précédant), étape spécifique au secteur culturel vers la titularisation, est donc non seulement rendue légitime par la nature discontinue de notre activité, mais également par son sens profond, philosophique et politique, qui nous rapproche des artistes. L’enjeu pour la Culture est bien l’accès au salaire attaché à la personne du fonctionnaire. Issu des caisses économiques et du conventionnement sous contrôle des travailleurs, c’est la richesse socialisée sous forme de cotisations qui rendrait possible ce salaire.
Lorsque le Pierre Gouletquer du dialogue de 2022 dit « nous sommes passés à côté d’une fonction moderne de notre métier », l’écho de Michel Clouscard résonne depuis la caverne de son Capitalisme de la séduction (1981) : « notre destin n’a pas été perdu. Il n’a jamais eu lieu (…). Notre destin est à faire. Tout commence, tout a commencé, par les rapports de production ».
La rédaction

Notes :
- [1] Les journées portes ouvertes ne permettent pas de se saisir de l’enjeu historique et de la légitimité à y participer ; on y consomme un résultat.
- [2] Cf. À bas l’Etat social.
- [3] Les révolutions scientifiques sont donc le fruit d’un décalage entre le hasard, la dose involontaire, et la conscience du chercheur capable de se projeter hors de son champ d’expertise. Il en va ainsi de Marx ou Einstein.
- [4] Au sens des classes populaires, à savoir les franges du prolétariat (ouvriers, employés, chômeurs) les plus exploitées ; les moins bien lotis géographiquement, culturellement et économiquement.
- [5] Abstraction langagière et signifiant vide lorsque l’on mesure réellement le niveau d’implication des agents dans la lutte concrète pour dénouer la discipline des chaînes qui la lie aux logiques du marché capitaliste de l’aménagement.
- [6] Cf. Misères de l’archéologie.
- [7] Cf. L’archéologie que nous construisons et Misères de l’archéologie.
- [8] Critère d’expérience et de validation des acquis techniques, preuve d’un certain nombre d’activités en lien avec la discipline, critère de cogestion et de financement pour des structures devant se dégager du marché, etc.
Pour prolonger en trois actes avec l’auteur :


Pierre Gouletquer
Chargé de Recherche au CNRS (retraité)
Ce long commentaire illustre parfaitement ce que m’écrivait Gréogor Marchand après la parution de la réédition de Préhistoire du Futur : «« En sens, Préhistoire du Futur ne t’appartient plus, il est patrimoinalisé, il est déconnecté de ton être actuel. C’était et c’est toujours un OVNI dans la production épistémologique française. »». J’en suis à la fois ému et admiratif. Ému parce que vous prolongez mes idées en y mettant de l’ordre. Impressionné car j’imagine que cela a représenté un énorme travail collectif de lecture, de réflexion et d’écriture. Grand merci à vous tous car cela me procure une fameuse cure de Jouvence.
C’est en préparant une conférence sur le thème « en quoi l’archéologie est-elle politique ? » plusieurs mois après la sortie de la réédition, que j’ai réalisé avoir pratiqué une archéologie buissonnière, un peu comme un enfant qui sèche l’école et part à l’aventure sans autre projet que de fuir la classe et de se laisser aller à la curiosité la plus primitive, sans interdit d’aucune sorte et sans crainte des punitions éventuelles.
Si des collègues géographes, ethnologues ou linguistes en mal de textes pour leurs revues ne m’avaient pas sollicité, je ne suis même pas certain que j’aurais rédigé les articles qui allaient devenir l’ébauche de Préhistoire du Futur. J’aurais sans doute pu me contenter de donner quelques conférences afin de partager mes curiosités et découvertes. Mon seul souci était d’échapper à la pression du Laboratoire de Rennes et à l’absurdité de devoir rendre des comptes au CNRS et au Ministère de la Culture, deux entités que je jugeais (et juge encore) antinomiques. Être loin de tout ça, en Afrique, dans le Finistère ou dans les classes de tous niveaux, au cœur même des problématiques de terrain, me suffisait pour justifier mon salaire.
Je n’ai jamais eu la prétention de révolutionner quoi que ce soit, ni de devenir un maître à penser ou un gourou-archéologue. Je me suis expliqué là-dessus au cours d’un séminaire de Geneviève Calame-Griaule, sans doute à la fin des années 1970 ou au début des années 1980. J’ai un temps regretté que l’archéologie n’ait pas engendré de grands penseurs de l’importance d’un Claude Levi-Strauss par exemple. André Leroy-Gourhan aurait pu tenir ce rôle, j’ai un peu échangé avec lui à ce sujet vers la fin de sa vie. Peut-être était-il lui-même trop dépendant de la matérialité de l’archéologie pour prendre la distance nécessaire, bien que « Préhistoire de l’Art occidental » représente une belle tentative d’y échapper. L’interdisciplinarité complexe est sans doute incompatible avec le mandarinat.
Mon idée à ce sujet a évolué : une personnalité d’envergure créerait un système bloqué, un dogme étayé de démonstrations péremptoires, là où la démarche réclame que l’enchaînement de questions nouvelles élimine sans cesse les certitudes. Seules les religions ont des certitudes. Les connaissances acquises à l’école buissonnière ne peuvent pas et ne doivent pas être récupérées par l’Institution, cela tuerait la curiosité.
C’est l’inverse qui doit se passer : la curiosité buissonnière est en droit de demander des comptes à l’Institution… sans obligation de se justifier. On s’aperçoit vite que l’État, prompt à faire valoir ses droits sur le patrimoine est bien plus frileux lorsqu’il s’agit de le gérer convenablement. Vaste sujet dont la seule cartographie des musées de préhistoire esquisse l’essentiel.
Cordialement à vous tous.
PG
J’oubliais : bravo pour les illustrations. J’accumule moi-même de mauvaises photos de bâtiments d’élevage en ruine et de décharges sauvages anciennes ou récentes. Mon rêve : organiser une fouille méthodique de la décharge qui nous servait à la fois de dépotoir et de terrain de jeu et de découverte dans les années 1940-1950.